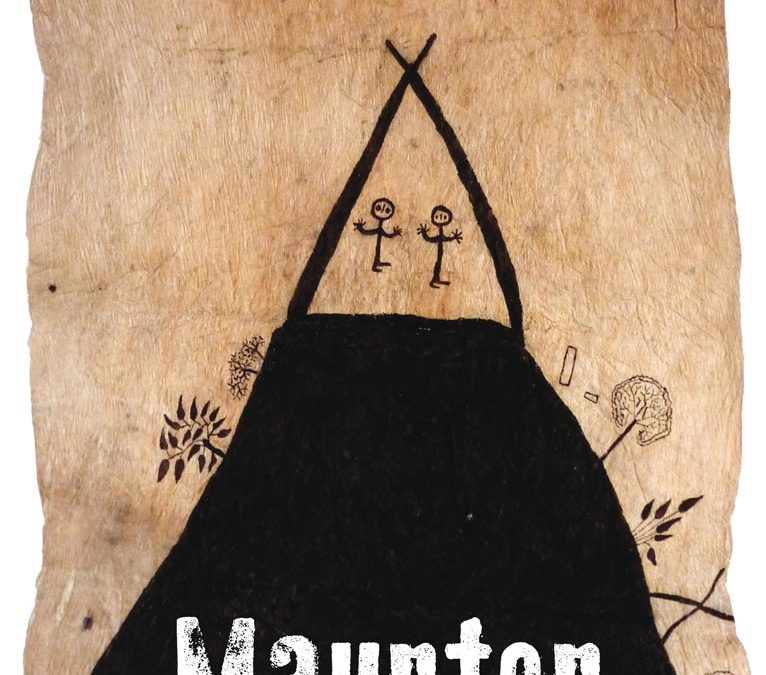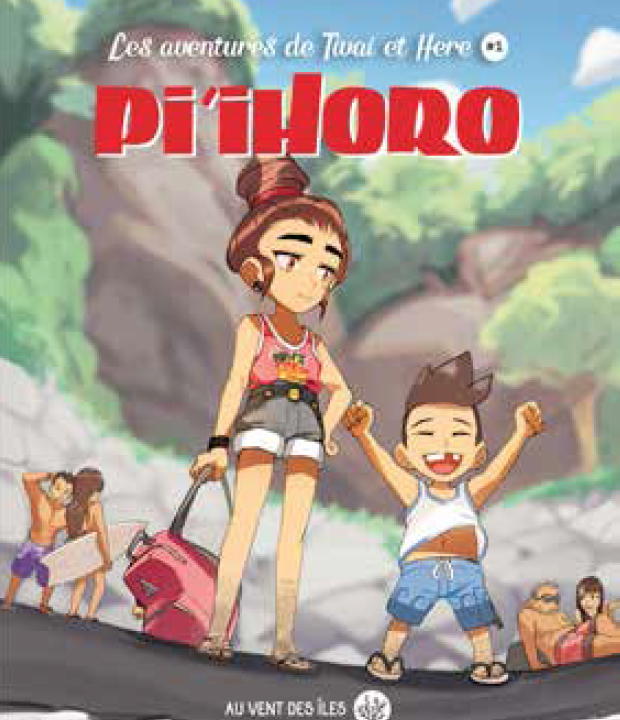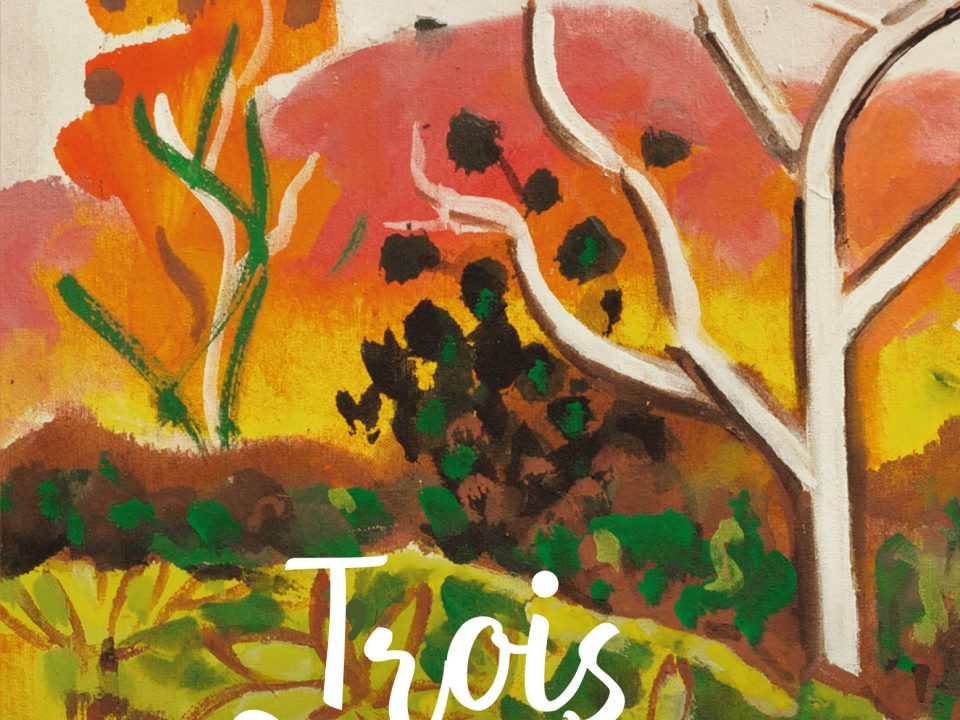TROIS FEMMES – Une impulsion
2 juin 2020
FAUX-SEMBLANT – Entretien avec Witi IHIMAERA
9 juin 2020Interview de Drusilla Modjeska, auteure de Maunten (qui signifie « la montagne » en tok pisin, langue véhiculaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée), par Mireille Vignol, traductrice de l’ouvrage.
EXTRAIT – En Papouasie, lui avait raconté Léonard, en des temps ancestraux, une vieille femme portait le soleil et la lune dans son bilum, son sac tressé. Tous les matins, elle gravissait la grande montagne dans l’obscurité et, quand elle atteignait le sommet, elle tirait le soleil de son sac et l’accrochait dans le ciel. Il diffusait de glorieux rayons qui scintillaient à travers les arbres afin que ses filles puissent apprécier l’abondance du monde. Émerveillées par sa beauté, elles peignaient tout ce que révélait la lumière éclatante et pure. Elles peignaient les feuilles, les fruits et les toiles d’araignée, les arêtes des poissons d’eau douce et les taches des chenilles. Et elles peignaient la montagne et ses nombreux sommets.
Quand elles étaient fatiguées et qu’elles avaient suffisamment travaillé pour un jour, la vieille femme remontait jusqu’à la cime de la montagne, décrochait le soleil, le rangeait dans son bilum et le remplaçait par la lune. Ses filles pouvaient alors se reposer, et elle pouvait se reposer avec elles. Bien que Rita eût été éduquée en Hollande, pays de la raison, une partie d’elle-même demeurait persuadée qu’un lieu capable d’engendrer un tel peuple, un tel imaginaire, ne pouvait qu’être un lieu de rédemption. Ainsi, quand Léonard lui avait annoncé qu’il s’apprêtait à se rendre là-bas, sur cette montagne, pour filmer ce peuple qui n’avait jamais cessé de peindre le monde dans lequel il vivait, elle lui avait dit que, oui, elle l’épouserait et l’accompagnerait.
Mireille Vignol, traductrice du roman :
Maunten est un roman en deux tomes : le premier se déroule avant l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) à la fin des années 60 et le début des années 70 (le pays a obtenu son indépendance de l’Australie en 1975) ; le second en 2005.
Dans le Tome 1, Rika, jeune future photographe hollandaise accompagne son mari, réalisateur de films ethnographiques, en PNG et dans le Tome 2, nous suivons Jericho, qui a passé sa petite enfance dans la montagne papoue et été éduqué en Angleterre, et revient « chez lui » pour répondre à ses obligations et se trouver.
Les deux rencontrent des difficultés à s’adapter à un pays auquel ils n’appartiennent pas complètement. Commençons par Rika, en quoi son expérience ressemble-t-elle à la tienne ?
Drusilla Modjeska, auteure :

Drusilla Modjeska, auteure de Maunten
La seule similarité, c’est que nous étions toutes les deux jeunes et naïves. Rika est un personnage romanesque. J’ai habité en PNG à cette époque, où mon mari d’alors, anthropologue dans la vraie vie, enseignait au sein de la nouvelle université (il effectuait des études de terrain dans une région qui ne figure pas dans le roman). C’était une période très exaltante. J’étais étudiante à l’université à Port Moresby, avec d’excellents professeurs venant du monde entier pour préparer la génération qui mènerait le pays à l’indépendance, dont la date était inconnue, mais l’échéance certaine.
Pour une jeune femme comme moi (originaire d’une région conservatrice de l’Angleterre), c’était une expérience extraordinaire qui a bouleversé ma vision du monde – de la notion d’impérialisme aux réalités du colonialisme, et bien d’autres choses. Elle a eu un profond impact sur ma vie. Le défi, quand j’ai voulu écrire sur cette époque et ce lieu, était de créer des personnages et une intrigue qui leur rendaient justice, qui rendaient justice à tous, en particulier aux habitants du pays. La nostalgie personnelle n’est pas une base suffisante pour un livre ! Ma propre histoire était ordinaire et de toute façon, le but n’était pas du tout de parler de moi, mais de faire revivre cette époque par le biais du roman. Alors Rika n’est pas moi. Et je ne suis certainement pas Rika. Les personnages sont réellement fictifs, même si typiquement, ils intègrent des éléments observés ou entendus, et reconstituent les dilemmes, conflits, et les perceptions vraies ou fausses qui existaient alors.
M. V. : Le roman est, entre autres, une grande histoire d’amour (ou l’histoire d’un grand amour) et d’amitié, soumise à l’épreuve du temps et des bouleversements de la vie.
Drusilla : Dans l’environnement universitaire, il existait de nombreuses relations amoureuses entre des jeunes femmes blanches, idéalistes, et les étudiants papous. Ces liaisons, qui causaient une grande consternation et la désapprobation en ville, étaient vues d’un bon œil par ceux d’entre nous qui faisaient tomber (ou croyaient faire tomber) les barrières, entraient dans une ère nouvelle. Pour les relations amoureuses les plus en vue, le fait d’être perçues comme le signe annonciateur d’un avenir idéalisé était aussi un lourd fardeau, car dans la réalité et le vécu, le stress des changements radicaux à venir pesait très lourd sur ces jeunes gens.
M. V. : Parlons des familles que représentent les groupes d’amis, certains étant originaires de pays lointains, d’autres étant papous, mais de régions lointaines de la capitale.
Drusilla : C’était une période si marquante et si particulière que de solides amitiés se formaient, surtout entre ceux qui étaient loin de leur pays natal – qui d’autre pouvait les comprendre ? De longues années ont passé, mais aujourd’hui encore, quand je rencontre des gens ayant vécu des expériences semblables (même si je ne les connaissais que peu ou pas du tout), nous avons immédiatement envie de revenir à cette époque et d’en parler. Vu de l’extérieur, il semble souvent incompréhensible que ce passé garde une telle emprise sur nous.
M. V. : D’autres amitiés résistent moins bien au temps, et les protagonistes semblent même avoir besoin de s’en détacher.
Drusilla : Certaines amitiés ont duré en se basant sur leurs expériences formatives partagées, mais oui, pour d’autres – comme dans le cas de Rika –, endommagées ou blessées, la tendance peut être inverse, et elles ont besoin de prendre du recul. Toutes les histoires n’ont pas une fin heureuse et les perspectives que nous avions cru partagées se sont parfois douloureusement fracturées. Les jeunes Occidentaux qui croyaient vivre un moment révolutionnaire avaient toujours l’option de retourner vers le confort de leurs emplois et de leurs existences en Europe ou en Australie. Pour les Papou-néo-guinéens, il était beaucoup plus compliqué d’appréhender les réalités néo-colonialistes de l’après-indépendance.
C’est le dilemme exploré dans le second tome de Maunten, quand les enfants des personnages précédant l’indépendance sont confrontés aux complexités (souvent secrètes) de leur passé et leurs effets sur un présent très différent.
M.V. : Dans cette seconde partie, on explore le statut de métis (hapkas en tok pisin) par le biais de Jericho. Mais ce mot « hapkas » est aussi utilisé par le poète papou, qui se dit être un hapkas existentiel, ou Rika qui est peut-être une hapkas émotionnelle.
Drusilla : J’ai toujours aimé ce mot « hapkas ». Il ne faut pas le confondre avec « half-caste » qui a une connotation coloniale et raciste. Half-caste (demi, métis) était un terme péjoratif, alors que hapkas est revendiqué et utilisé avec fierté. J’ai souvent entendu des enfants se présenter comme hapkas quand leurs parents proviennent de régions différentes de PNG ou lorsqu’ils habitent en ville tout en visitant les villages de leur famille. Au lieu d’être moitié, il sous-tend la fierté d’être plus qu’une unité, de savoir naviguer entre plusieurs unités.
Dans Maunten, c’est aussi un terme revendiqué par Milton, le poète et vieil ami de Rika, un homme intelligent et honorable qui n’a pas choisi la facilité de l’argent offert à beaucoup de personnes éduquées après l’indépendance. Il lisait James Baldwin dans le tome 1, mais en 2005, il n’a plus la même ferveur révolutionnaire : il est devenu un réaliste qui observe avec noirceur un présent corrompu. Il a toutefois la sagesse de percevoir la vie dans des perspectives différentes, avec la passion du poète et de l’intellectuel. Il n’incarne pas la défaite, mais les possibilités restantes, les vérités durement acquises, le pouvoir autochtone du non-occidental qui peut embrasser la sagesse du pays, de la terre, de l’être au sein de la nature – en même temps que les questions philosophiques qui se posent à nous – à nous tous – grâce aux poètes et philosophes du monde entier.
Pour Jericho et pour Bili, tous deux issus d’amours relatés dans la première partie du livre, les dilemmes sont beaucoup plus sévères. Il n’existe aucune réponse facile quand Jericho – éduqué à Oxford – vient retrouver Bili – éduquée et employée en PNG. Ils doivent trouver une résolution, au niveau personnel et politique, à la question d’où ils choisiront de vivre, et comment.
EXTRAIT – » Existe-t-il meilleur symbole d’une Papouasie-Nouvelle-Guinée indépendante, demanda Aaron, que l’abondant plumage de nos coiffes échangé par nos tribus et allant jusqu’à représenter notre île, façonnée comme un oiseau ? Mais les symboles n’ont pas seulement valeur d’idéal ; les symboles sont aussi des mises en garde.
L’histoire de nos plumes est un miroir de notre pays, mais ce miroir ne reflète pas notre caractère ; il reflète celui des colons et des négociants, des collectionneurs, des naturalistes, des chasseurs de prime. Et c’est leur perception de nous qui nous est renvoyée comme étant la nôtre. Quand Magellan rapporta des paradisiers dépourvus d’ailes et de pattes au roi d’Espagne, ces oiseaux firent l’objet d’idées fausses aussi incroyables que leur plumage. Les récits de Passaros de sol et d’Avis paradiseus volant jusqu’à leur mort sans jamais se poser sont devenus des métaphores pour la poésie européenne, et nous nous sommes retrouvés associés au mythe : un peuple aussi étrange que ses oiseaux. »
M. V. : Revenons sur la perception de la PNG dans le monde et son impact sur la perception que les Papous ont d’eux-mêmes. En plus du mélange de peur et de fascination, il y a un éclairage intéressant sur la vision imaginaire des surréalistes au début du 20ème siècle.
Drusilla : Ah, les surréalistes. Je les ai découverts en PNG quand j’ai vu la carte du « Monde au temps des surréalistes » élaborée en 1929 par André Breton, aussi collectionneur d’art océanien. À l’époque (j’étais jeune !), il m’avait semblé incroyablement avant-gardiste de considérer l’art d’Océanie avec sérieux, un art à part entière et non pas de simples curiosités ethnographiques ou, pire, des objets païens qui devaient être détruits par les missionnaires. Mais, je le répète, j’étais jeune.
Je me suis aperçue (bien sûr) que la fascination avec le « primitivisme » pour le surréalisme (et d’autres expressions du modernisme) étaient empreinte d’une perspective coloniale, une altération exotique qui s’emparait d’une œuvre d’art – achetée pour trois fois rien et revendue au prix fort – et la valorisait en tant que contrepoint fantasmé et romancé de l’Europe ravagée par la guerre dans les années 1920. Je continue à trouver le Monde au temps des surréalistes plutôt merveilleux avec la Mélanésie au beau milieu, les Etats-Unis oblitérés et le Grande-Bretagne en grain de sable à côté de l’Irlande. Mais elle est un simple produit des fantasmes et du commerce européens, elle n’a rien à voir avec les réalités de l’Océanie.
Si je l’aime aussi, autant romancée soit-elle, c’est que du point de vue de l’Australie au 21è siècle, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est trop souvent perçue comme un lieu de violence et de corruption, ignoré ou stéréotypé par les médias, méprisé (alors que des compagnies s’engraissent en détruisant les villages et l’environnement.) Des anthropologues travaillent dans le pays et certains font un excellent travail, mais leurs écrits et leur éclairage sortent rarement de leur discipline universitaire. La vision sombre et simpliste véhiculée par les grands médias est pénible pour les Papou-néo-guinéens, que ce soient ceux dont la subsistance dépend de compagnies australiennes, d’ONGs, d’universités et autres, ou que ce soient, au niveau des villages, ceux qui sont confrontés aux exploitants miniers et forestiers (chinois et malaisiens ainsi qu’australiens) et (trop souvent) à l’arrogance de touristes. Que peuvent-ils penser de ces gens ignorants, qui promettent monts et merveilles et leur offrent presque toujours une pitance ? C’est très difficile pour eux.
M. V. : Les tapa (peintures sur tissus d’écorce) sont au cœur du roman. Peux-tu nous parler de cette forme d’art océanien ?
Drusilla : En 2004, j’ai fait un reportage à ce sujet chez le peuple Ömie, dans la province d’Oro. Il vit en altitude, sur les flancs du volcan Mont Lamington, dont la dernière éruption remonte à 1951. C’est une montagne escarpée, difficilement accessible, et l’administration australienne s’y est seulement aventurée pendant la seconde guerre mondiale, pour recruter les jeunes hommes comme porteurs dans le bataille sanglante de la piste de Kokoda au pied de leur montagne. Après la guerre, les villages de basse altitude ont adopté le mode de vie dicté par les missionnaires et ont renoncé à l’art du tapa, alors que ceux des villages du haut n’ont pas voulu des missions et ont continué à pratiquer leur superbe forme d’art. J’y suis allée en tant que journaliste, avec un petit groupe qui comptait aussi un spécialiste australien en art océanien. Grâce à lui et à la coopérative qu’il a établi, les tapa sont maintenant exposés dans des galeries et musées en Australie, en Europe, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Les revenus sont utilisés pour la santé, l’éducation et les besoins (citernes d’eau etc.) des Ömie.
(Vous pouvez lire – en anglais – l’essai de Drusilla Modjeska écrit à l’occasion de l’exposition : The Wisdom of the Mountain, en 2009 à la National Gallery of Victoria.)
https://www.drusillamodjeska.com/downloads/DrusillaModjeska-Fabricofwisdom.pdf
Le peuple montagnard de Maunten s’inspire de mon expérience avec les Ömie, pour ce qui est de leur art et de leur environnement. Mais le roman n’a absolument rien d’ethnographique. Je me suis inspirée des rares recherches anthropologistes et les personnages de Maunten sont un mélange d’expérience et de recherches.
M. V. : Tu as co-fondé SEAM, un programme d’alphabétisation. Comment fonctionne-t-il ?
Drusilla : Les programmes de SEAM ont été repris l’an dernier par KTF, une ONG de Sydney (https://www.ktf.ngo). Un des projets initié par SEAM, Making Books, consiste à travailler avec des enseignants pour fabriquer des petits livres avec les enfants, d’une part pour raconter les histoires coutumières (avec la participation des anciens) et d’autre part pour publier les écrits des enfants et réaliser des manuels destinés au primaire. (Par exemple, des abécédaires illustrés par les enfants ; livres de plantes locales avec les noms botaniques, anglais et en langue vernaculaire, etc.) Ces éditions limitées – parfois même des productions uniques – sont utilisées dans les écoles et ont rencontré beaucoup de succès auprès des enfants, des enseignants et des parents.
M. V. : La traduction française de Maunten est publiée par la maison d’édition basée à Tahiti, Au vent des iles, qui est également responsable de la première traduction en français d’un roman papou avec Maiba, de Russell Soaba. Peux-tu nous parler de cet écrivain et poète que tu cites et remercies dans Maunten ?

Russell Soaba, écrivain et poète papou, avec son bilum, sac tressé.
Drusilla : La poésie du personnage de Milton est basée sur la poésie de Russell Soaba. C’est un grand poète papou-néo-guinéen, un grand poète tout court, un homme digne et passionné. Cependant, si la poésie de Milton est basée sur celle de Soaba (avec sa permission), je tiens à souligner encore une fois que la vie du personnage n’a rien à voir (si ce n’est qu’il était étudiant à l’université à la même époque) avec celle de Russell Soaba. Je lui dois beaucoup, en tant qu’ami et collègue, et j’ai beaucoup d’admiration pour son œuvre.
Les oiseaux de paradis
chantent à bref intervalle
mais, comme le temps
les y a destinés, ils s’évaporent dans des abîmes d’un
vert dru, dans les abîmes de quelque sombre océan.
Parfois, solitaire,
un oiseau siffle…
Russell Soaba, Naked Thoughts – Poems and Illustrations, 1978 (en introduction au Tome 2 de Maunten)
M. V. : Finalement, et malheureusement, le festival « Etonnants Voyageurs » a dû être annulé. Qu’en attendais-tu ?
Drusilla : Je ne savais pas à quoi m’attendre – ce qui rendait l’aventure d’autant plus intrigante et je suis très déçue de ne pas pouvoir y participer. J’avoue que je suis un peu timide, étant anglophone monolingue, mais j’espérais pouvoir m’asseoir discrètement, écouter et apprendre. Les gens comme moi, les auteurs anglophones, ont beaucoup à apprendre d’autres endroits au monde, de perspectives nouvelles, de manières de vivre différentes, surtout en ce moment de crise existentielle où le capitalisme néo-libéral a causé tant de dégâts, la santé de la planète n’étant pas le moindre.
J’espère que tous ceux qui auraient dû se trouver à St Malo sont sains et saufs. Et j’attends avec impatience de pouvoir lire leurs œuvres.
Références :
- Maunten de Drusilla Modjeska, (traduction Mireille Vignol), publié chez Au vent des îles, 2019
- Maiba de Russell Soaba, (traduction Mireille Vignol), publié chez Au vent des îles, 2016